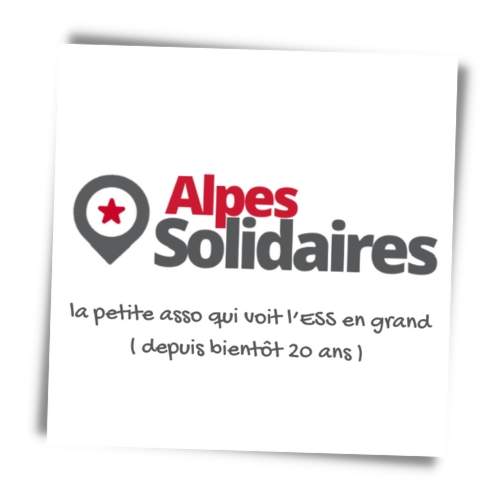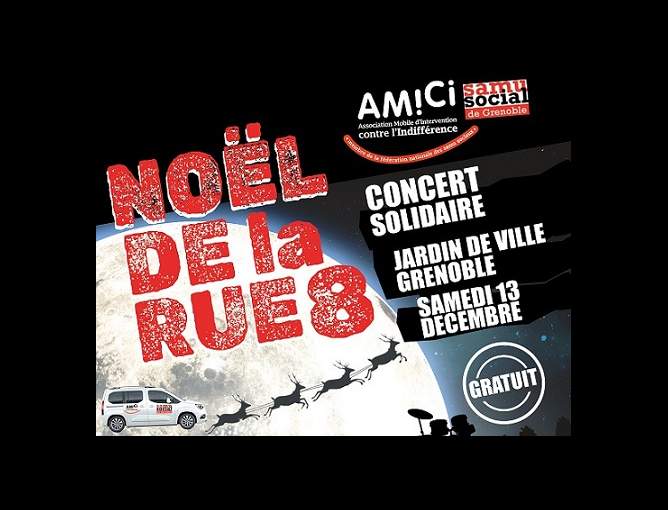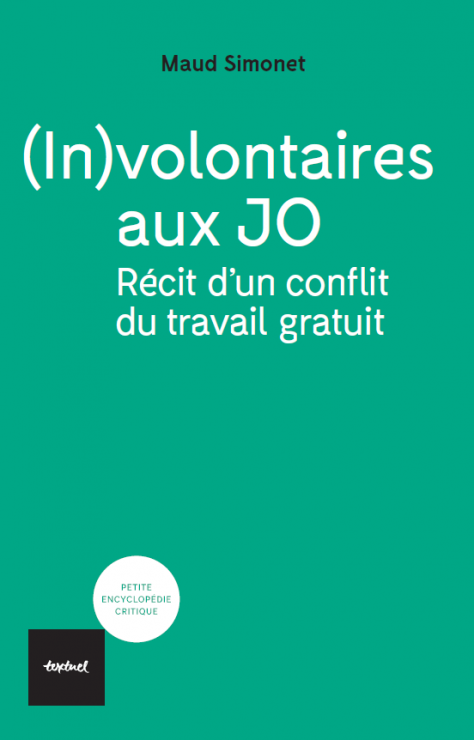Soirée-débat « À la recherche du plein emploi » 3 juillet 2025
Avec Laurent Pinet, président de Coraace et coprésident d’Isactys
Partie 3 : imaginer ensemble pour bâtir un plein emploi juste et inclusif
Les débats mouvants
La soirée s’est poursuivie par des débats mouvants, dont le principe est de diviser physiquement la salle en trois « zones » : les pour, les contre et les indécis. Les participants devront se placer dans un camp ou dans l’autre après l’énoncé de chacune des trois affirmations retenues pour entretenir le débat. Ils sont ensuite invités à tout moment à changer (littéralement, pour le coup) de position selon la teneur des débats et les prises de paroles. L’idée, c’est que ces mouvements « physiques » permettront de refléter plus encore la pluralité, la diversité, en un mot toute la richesse des points de vue de l’assemblée sur le sujet. Et ainsi faire émerger une pensée collective.
Premier débat (conduit par Magda Mokhbi) : les conséquences de la quête du plein emploi sur les personnes qui n’ont pas de travail.
*Atteindre l'objectif d'un taux de chômage à 5 % suppose et permet d'embaucher tous celles et ceux qui veulent travailler*

Magda Mokhbi apporte quelques précisions préalables : d’abord, ce chiffre de 5% est en lien avec le chômage nommé « frictionnel » ou « d’adaptation », donc le chômage temporaire entre deux contrats de travail. Ainsi, atteindre l’objectif de 5% pourrait probablement rendre possible l’embauche de toutes celles et ceux qui souhaitent travailler ; par ailleurs, pouvoir donner un travail à toutes celles et ceux qui veulent travailler nécessite de mettre les moyens nécessaires pour ce faire, qui est donc une condition antérieure à l’objectif énoncé.
Les personnes présentes se positionnent ensuite sans trop d’hésitation, avec une majorité dans la partie « contre » de la salle, quelques-unes au centre, bien peu dans la partie « pour ». Comme dans les deux débats suivants, certaines reviendront sur leur position au cours des échanges.
Tous soulignent rapidement que le sens des mots a son importance, et que pour répondre le plus précisément possible à cette affirmation, encore faudrait-il définir plus précisément la notion de travail, et ce qui le différencie du terme « emploi ».
Les rares personnes qui se sont positionnées « pour » mettent en avant plusieurs conditions préalables pour pouvoir embaucher tous ceux qui veulent travailler : davantage de moyens, d’abord, mais aussi plus largement une refondation de notre modèle social et économique, en intégrant par exemple les personnes les plus éloignées du monde du travail, à l’instar des personnes porteuses d’un handicap, dans l’optique d’une société plus égalitaire. Il faudrait aussi se diriger vers une reconnaissance du travail non rémunéré et des métiers d’utilité sociale, avec comme horizon un monde plus juste qui permet un épanouissement professionnel pour toutes et tous. Sans oublier également le droit à ne pas travailler, qui doit pouvoir exister pleinement dans nos sociétés.
Du côté des « contres », on met en exergue les difficultés que rencontrent certains secteurs pour recruter, du fait de conditions de travail contraignantes, du manque de sens dans les missions et les tâches demandées… Le fossé qui se creuse entre les anciennes et les nouvelles générations, aussi – moins promptes à accepter n’importe quel travail et à n’importe quelles conditions –, ainsi que celui qui ne cesse de s’élargir entre les riches et les pauvres.
L’assistance défend ainsi plusieurs mesures, telles qu’un accompagnement socio professionnel effectif, qui nécessite des moyens pour lever les freins sociaux à l’emploi, une meilleure reconnaissance de l’engagement bénévole et associatif, et surtout un ajustement des rémunérations proposées par les employeurs. Plus encore, il est important de recentrer le débat sur la responsabilité des entreprises dans le processus d’embauche et éviter la culpabilisation et la stigmatisation des personnes en recherche d’emploi, en vogue actuellement et depuis de nombreuses années d’ailleurs.
Second débat (mené par Jean-François Périnel) : les conséquences de la quête du plein emploi sur les personnes qui ont un travail.
*Le plein emploi met les salariés en position de force pour négocier salaire et conditions de travail*

On trouve de nouveau peu de personnes dans la partie « pour », elles sont plus nombreuses au centre que lors du premier débat, mais encore une fois la majorité se déplace dans le camp des « contre ».
Sont évoqués le secteur de la restauration ou encore certains postes dans celui de la santé, où il est impossible de négocier le salaire ou un quelconque avantage. La marge de manœuvre dans les négociations est intimement liée à la catégorie socio-professionnelle, et ne sera pas la même pour un cadre ou pour un ouvrier ou un salarié lambda. D’autant plus qu’atteindre le plein emploi suppose toujours le sous-emploi, l’intérim, l’emploi vulnérable ou précaire.
D’autre part, les injonctions vis-à-vis de la recherche d’emploi et les mesures répressives qui les accompagnent – suspension des allocations, radiation… – obligent bien souvent les gens à accepter des emplois mal rémunérés et parfois même vides de sens. Les mesures de coercition actuellement à l’œuvre rendent impossible toute négociation. D’autant plus si celles-ci se font à titre individuel, sans passer par des luttes et des revendications collectives, via les syndicats par exemple. En ces temps d’économie libérale généralisée, les négociations sont essentiellement fondées sur un rapport de force car le contrat de travail reste encore et toujours un contrat de subordination.
Troisième et dernier débat (animé par Gérard Lavaud) : les conséquences du plein emploi sur le travail et la société en général.
*L'objectif de plein emploi répond aux enjeux de société du bien-vivre, florissante, plus humaine, solidaire et écologique*

Parmi les personnes qui se sont positionnées « pour » (peu nombreuses encore une fois), cette affirmation peut faire sens si elle est précédée et s’accompagne d’une reconnaissance du travail dans les domaines de la solidarité humaine et sociale, et de l’écologie. Une nouvelle fois durant les échanges qui ont rythmé cette soirée, les intervenants soulignent la nécessité de proposer un accompagnement individuel effectif et réel qui soit en adéquation avec les besoins des personnes.
Du fait de cet énoncé à la portée généraliste, les personnes « contre », de nouveau plus nombreuses, avancent des arguments qui embrassent des thématiques variées. Le modèle de société capitaliste est pointé du doigt, dans le sens où, à rebours d’une société « du bien-vivre, florissante, plus humaine, solidaire et écologique », il semble n’avoir comme unique but de créer toujours plus de richesses. Ces dernières seront d’ailleurs toujours captées par les plus riches, bien qu’elles soient pourtant créées par les salariés. En outre, une situation de plein emploi ne permet pas nécessairement d’éradiquer la pauvreté et la précarité : même pendant les périodes de plein emploi, on trouvait encore des travailleurs pauvres et des personnes en situation de précarité.
La question du sens du travail est importante : on constate une vraie différence de vision entre les décideurs politiques, mis en place par un électorat plus âgé, et les jeunes générations. Celles-ci aspirent aujourd’hui à d’autres sources d’épanouissement que le travail, qui dans de nombreux secteurs, ceux de la santé ou du social par exemple, ne rime pas ou très peu avec les notions de « bien-être » et de « bien-vivre ». Si l’on veut aboutir à une société de plein emploi désirée et désirable, il faut parvenir à faire reconnaître pleinement toutes les formes de travail, telles que l’activité associative.
Laurent Pinet en appelle lui aussi à un changement de paradigme sur les questions de travail et d’emploi, dont il regrette qu’elles soient systématiquement abordées à l’aune du rapport de force. N’y a-t-il pas une autre façon de l’envisager ? Par exemple de manière plus solidaire et même nationalement solidaire, pour signifier avec force qu’il s’agit d’une question vraiment collective, démocratique et républicaine. Il rappelle d’ailleurs que l’alinéa 5 du préambule de notre constitution stipule que « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
En conclusion : le débat et l’échange au cœur du « monde et modèle d’après »
Pour clore cette soirée-débat, Philippe Urvoa remarque qu’à l’issue de ces échanges riches et constructifs, un enjeu important est de savoir ce qu’on met derrière les mots de « plein emploi », « travail », « emploi », « chômage » … En soi tout un sujet, qui pourrait à lui seul faire l’objet d’un séminaire de plusieurs jours ! Cela étant, les débats et les prises de parole de chacun révèlent clairement une déconnexion entre la manière dont le gouvernement actuel envisage cette société de plein emploi et la vision qu’en ont une majorité des participants, qui n'appréhende pas les choses tout à fait de la même façon, tant à l’échelle politique qu’individuelle.
Laurent Pinet, interrogé sur les actions à mettre en place une fois ce constat établi, précise que de nombreuses voies sont possibles, tout en reconnaissant qu’une simple soirée de débats telle que celle-ci, « ça fait (déjà) un bien fou » ! Convaincu que le système actuel va « droit dans le mur », il invite à se préparer et à penser au monde et au modèle d’après, qui passera nécessairement par une nouvelle façon d’interagir entre nous et de produire du « bien collectif ». À plus court terme, le président de Coorace et coprésident d’Isactys met en garde l’assistance vis-à-vis des prochaines échéances démocratiques et électorales, conseillant d’éviter l’exclusion de « l’autre » d’un débat public qui ne fait selon lui qu’agiter les peurs, car « c’est souvent en agitant les peurs qu’on produit le pire ». Au contraire, « c’est en remettant du débat, de l’échange, entre individus incarnés et pas seulement entre individus pixelisés, qu’on arrive à se comprendre, à se connaître pour mieux se reconnaître, et se reconnaître pour faire mieux ensemble ».
Aurélien Mathé pour Alpes Solidaires (avec le concours de Floriane Bajart et Marie de Lozinskiy).
Découvrez les autres temps forts de la soirée-débat sur le plein emploi :
-
Partie 1 : 50 années de politiques publiques en quête de plein emploi
- Partie 2 : La loi plein emploi : enjeux et controverses