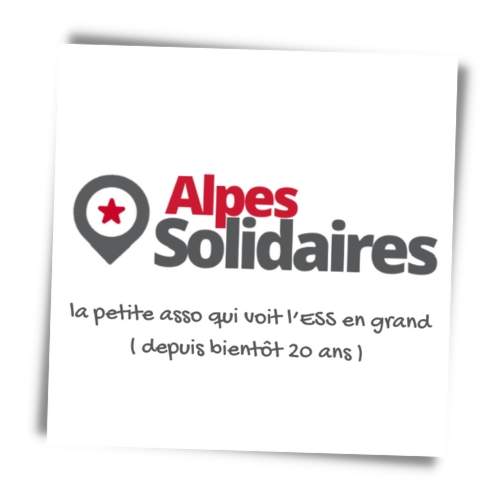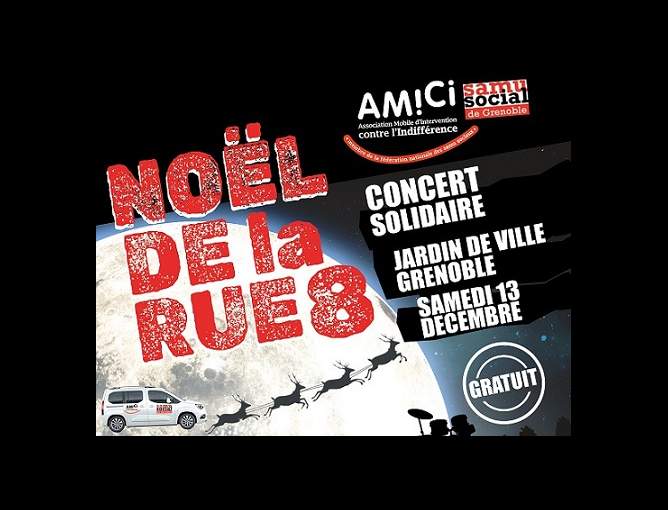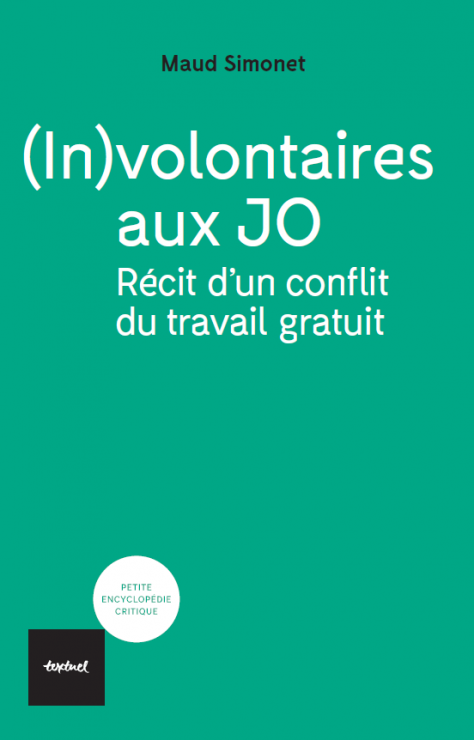Soirée-débat « À la recherche du plein emploi » 3 juillet 2025
Avec Laurent Pinet, président de Coraace et coprésident d’Isactys
Partie 1 : 50 années de politiques publiques en quête de plein emploi
Le 3 juillet dernier, quelques dizaines de personnes ont bravé la canicule pour se réunir à la Maison de la vie associative et citoyenne de Grenoble. À l’initiative d’Alpes Solidaires, une soirée-débat était organisée autour des conséquences de la recherche du plein emploi, sur les individus – dont les travailleurs mais aussi les personnes privées d’emploi – et plus généralement sur la société.
Convié en tant que « grand témoin » de la soirée, Laurent Pinet a éclairé, orienté, complété les échanges et les débats. Celui qui fut longtemps à la tête d’Ulisse à Grenoble est aujourd’hui président de la fédération nationale Coorace1 et occupe également les fonctions de codirecteur du groupe économique solidaire Isactys, qui oeuvre autour de l’insertion par l’activité économique.
Plusieurs structures du réseau Alpes Solidaires étaient représentées avec notamment Magda Mokhbi, directrice des Ateliers Marianne ou encore Gérard Lavaud, cofondateur d’Oeuvrières et Oeuvriers d’un Monde Meilleur. Tous deux ont d’ailleurs pleinement participé à l’animation de la soirée comme du débat mouvant qui a suivi, en compagnie du « maître de cérémonie » Philippe Urvoa, de Dédale, l’emploi social et solidaire et spécialiste des questions de l’ESS, et de Jean-François Périnel, cofondateur de la SCOP Webu. À noter aussi la participation du Comité Territorial des SCOP et SCIC en Isère.
Le secteur de l’insertion par l’activité économique : un temps d’avance sur les pouvoirs publics en matière d’emploi et d’inclusion
Guidé par le préambule et les questions de Philippe Urvoa, Laurent Pinet a d’abord pris la parole pour tenter de définir et analyser la notion de « plein emploi ». L’occasion de retracer une histoire des politiques publiques de l’emploi en France durant ces dernières décennies et de constater que le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) a toujours eu un temps d’avance sur les pouvoirs publics et les politiques lancés dans cette quête du plein emploi. Comment expliquer plus généralement que les pouvoirs publics n’aient jamais réussi à faire reculer significativement le chômage alors que de nombreuses pistes et solutions concrètes sont proposées, depuis longtemps déjà, par les corps intermédiaires et les acteurs de la société civile, et plus spécifiquement de l’IAE ?
Dès la fin des années 70, des travailleurs sociaux expérimentent en effet des approches novatrices en alliant activité économique viable et travail social, avec comme objectif l’insertion de publics précaires, en général des personnes longtemps éloignées de l’emploi ou faisant face à des difficultés sociales et professionnelles particulières (le handicap par exemple). Différentes structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) voient alors le jour et proposent, entre autres exemples, des contrats de travail au sein de chantiers, d’ateliers ou d’entreprises d’insertion, mais aussi un accompagnement socio-professionnel spécifique et personnalisé. À noter que près de 70% des personnes passées par les SIAE se dirigent ensuite vers un emploi ou une formation, tandis qu’elles sont 30% à trouver un emploi durable, selon Territoires insertions 38, une association qui regroupe plus de 80% des SIAE iséroises conventionnées par l’état.
Ces résultats probants vont attirer l’attention des pouvoirs publics qui vont ainsi peu à peu considérer les acteurs de l’IAE comme légitimes et efficaces, puis légiférer pour acter cette reconnaissance et les institutionnaliser. Une bonne chose en soi, mais Laurent Pinet remarque que les politiques et les décideurs, constatant que le modèle proposé par l’IAE se distingue non seulement par son efficacité sur l’emploi mais aussi par sa rentabilité, s’emploient souvent à le phagocyter en favorisant l’émergence d’un marché lucratif dans ce secteur. Il regrette ainsi que les décideurs aient trop souvent la tentation de confier sa gestion au secteur privé, dans une logique court-termiste de profit qui ne cadrent pas forcément avec les valeurs premières de l’IAE.
Selon le président de Coorace, investir le champ de l’IAE sur une base uniquement financière et économique ne peut qu’en dévoyer la démarche et assécher les ressources, les moyens et les capacités d’action des pionniers qui ont fait la preuve de l’efficacité de leur approche.
Les politiques publiques de l’emploi ces cinquante dernières années
Laurent Pinet poursuit son propos en distinguant cinq grandes séquences pour balayer l’évolution des politiques de l’emploi. Comme pour la récente loi pour le plein emploi, qui a été adoptée dans une période où le chômage remonte sensiblement, un aperçu des politiques publiques en matière d’emploi menées ces cinquante dernières années illustre pour celui-ci leur l’aspect anachronique et la désynchronisation entre les problèmes tels qu’ils se posent et les solutions que le législateur y apporte.
1ère séquence : années 70/80
Cette période voit l’apparition d’un chômage structurel (notamment à la suite de la crise économique provoquée par les deux chocs pétroliers) : on commence à parler de « chômage de masse ». Les gouvernements décident dans un premier temps d’amortir les effets sociaux de cette montée du chômage avec le renforcement de l’indemnisation du chômage ou encore des mesures de préretraite.
2ème séquence : années 80/90
Les décideurs prennent conscience que le chômage devient structurel, et qu’il faut donc y apporter des réponses elles aussi structurelles, avec des politiques actives de l’emploi. C’est la grande époque des contrats aidés – contrats emploi solidarité, TUCS (travaux d’utilité collective) pour les jeunes… C’est aussi l’époque où le secteur de la formation professionnelle se développe. Le RMI (revenu minimum d’insertion), ancêtre du RSA, est par ailleurs créé en 1988.
3ème séquence : 90/2000
Dans un contexte de mondialisation et de concurrence internationale, la réduction du coût du travail devient le nouveau crédo – toujours en vigueur aujourd’hui ! – pour combattre le chômage. Les politiques vont donc agir sur la politique de l’offre en incitant les entreprises à embaucher, notamment par le biais d’un allègement des charges.
4ème séquence : 2000/2010
À l’instar du modèle anglo-saxon, on va agir sur la flexibilité, avec l’émergence de la notion de « flexisécurité »2, puis la création de Pôle Emploi. Suivront des mesures comme les contrats de professionnalisation, le RSA (revenu de solidarité active) etc. C’est à cette période qu’on commence à généraliser l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi.
5ème séquence : 2010/2020
En cette période de crise financière, le maître-mot devient « efficacité » : les moyens manquent, tout ce qu’on met en place doit donc être efficace. Dans une logique de sous-traitance, Pôle Emploi va commencer à confier des missions à des opérateurs privés, censés être plus efficaces, selon le dogme capitaliste. « De fait, on s’aperçoit maintenant que ça ne marche quand même pas bien mieux », note Laurent Pinet.
Depuis 2020…
On va ramener la responsabilité sociale du chômage à une responsabilité individuelle plutôt que collective. Une tendance symbolisée par les propos d’Emmanuel Macron lorsqu’il déclarait lors de son premier mandat qu’il suffit de « traverser la rue » pour trouver du travail… On assiste à une réelle stigmatisation des chômeurs, considérés quasiment comme seuls et uniques responsables de leur situation. Une manière d’envisager ces problématiques – bien plus complexes pourtant –, dont la loi sur le plein emploi peut être vue comme une forme d’aboutissement.
La valse quasi permanente des doctrines politiques autour de la question de l’emploi est révélatrice d’un constat d’échec. Les pouvoirs publics n’ont semble-t-il pas toujours su entendre ou même prendre suffisamment tôt en compte les solutions proposées par les acteurs de l’IAE. De nombreuses structures de l’IAE ont par exemple déployé des activités innovantes, dans le domaine notamment de la transition écologique et sociale (agriculture, espaces verts, rénovation, réemploi…). « Cela démontre pour moi à quel point on est sur un sujet qui doit avant tout favoriser la prise en compte et la mobilisation des acteurs d’un territoire pour trouver des solutions ensemble, » avance Laurent Pinet. « Et que ce n’est pas par la verticalisation ou l’imposition en tous points du territoire d’une politique unique de l’emploi qu’on parvient à trouver des solutions aux problèmes posés. »
1. Coorace est un un réseau généraliste qui rassemble, dans une logique de coopération, des associations, des ateliers et chantiers d’insertion, des entreprises d’insertion et de travail temporaire d’insertion, mais aussi des partenaires concernés par ces questions d’emploi et d’inclusion, comme des organismes de formation, des associations de service à la personne, des entreprises…
2. Néologisme et mot valise constitué des termes « flexibilité » et « sécurité » la flexisécurité est un dispositif social qui offre aux entreprises de plus grandes facilités de licenciement (et donc de recrutement) tout en garantissant aux employés licenciés des indemnisations longues et conséquentes.
Aurélien Mathé pour Alpes Solidaires (avec le concours de Floriane Bajart et Marie de Lozinskiy).
Découvrez les autres temps forts de la soirée-débat sur le plein emploi :
- Partie 2 : La loi plein emploi : enjeux et controverses
-
Partie 3 : imaginer ensemble pour bâtir un plein emploi juste et inclusif